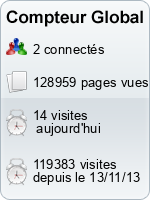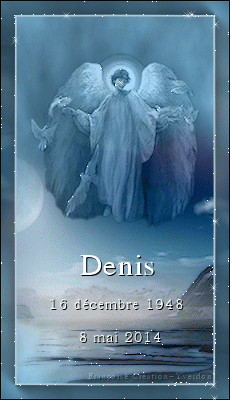-
Par sylvie erwan le 9 Avril 2022 à 07:35

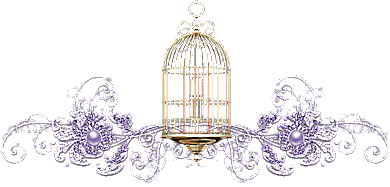
À un lilas.
Je vois fleurir, assis à ma fenêtre,
L'humble lilas de mon petit jardin,
Et son subtil arôme qui pénètre
Vient jusqu'à moi dans le vent du matin.
Mais je suis plein d'une colère injuste,
Car ma maîtresse a cessé de m'aimer,
Et je reproche à l'innocent arbuste
D'épanouir ses fleurs et d'embaumer.
Tout enivré de soleil et de brise,
Ce favori radieux du printemps,
Pourquoi fait-il à mon cœur qui se brise
Monter ainsi ses parfums insultants ?
Ne sait-il pas que j'ai cueilli pour elle
Les seuls rameaux dont il soit éclairci ?
Est-ce pour lui chose si naturelle
Qu'en plein avril elle me laisse ainsi ?
– Mais non, j'ai tort, car j'aime ma souffrance.
A nos amours jadis tu te mêlas ;
Au jardin vert, couleur de l'espérance,
Fleuris longtemps, frêle et charmant lilas !
Les doux matins qu'embaume ton haleine,
Les clairs matins du printemps sont si courts !
Laisse-moi croire, encore une semaine,
Qu'on ne m'a pas délaissé pour toujours.
Et si, malgré mes espoirs pleins d'alarmes,
Je ne dois plus avoir la volupté
De reposer mes yeux brûlés de larmes
Sur la fraîcheur de sa robe d'été ;
Si je ne dois plus revoir l'infidèle,
J'y penserai, tant que tu voudras bien,
Devant ces fleurs qui me virent près d'elle,
Dans ce parfum qui rappelle le sien.
François Coppée.
Recueil : Le cahier rouge (1892).
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par sylvie erwan le 19 Juin 2021 à 08:33
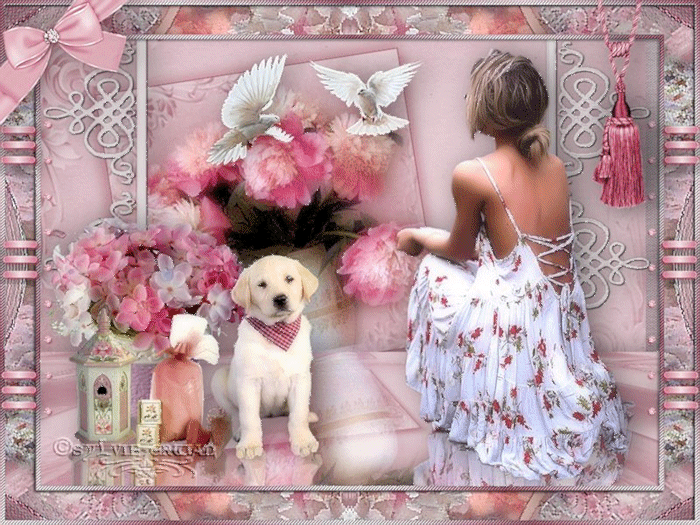

En printemps …
En printemps, quand le blond vitrier Ariel
Nettoie à neuf la vitre éclatante du ciel,
Quand aux carrefours noirs qu’éclairent les toilettes
En monceaux odorants croulent les violettes
Et le lilas tremblant, frileux encor d’hier,
Toujours revient en moi le songe absurde et cher
Que mes seize ans ravis aux candeurs des keepsakes
Vivaient dans les grands murs blancs des bibliothèques
Rêveurs à la fenêtre où passaient des oiseaux…
Dans des pays d’argent, de cygnes, de roseaux
Dont les noms avaient des syllabes d’émeraude,
Au bord des étangs verts où la sylphide rôde,
Parmi les donjons noirs et les châteaux hantés,
Déchiquetant des ciels d’eau-forte tourmentés,
Traînaient limpidement les robes des légendes.
Ossian ! Walter Scott ! Ineffables guirlandes
De vierges en bandeaux s’inclinant de profil.
Ô l’ovale si pur d’alors, et le pistil
Du col où s’éploraient les anglaises bouclées !
Ô manches à gigot ! Longues mains fuselées
Faites pour arpéger le coeur de Raphaël,
Avec des yeux à l’ange et l’air » Exil du ciel » ,
Ô les brunes de flamme et les blondes de miel !
Mil-huit-cent-vingt… parfum des lyres surannées ;
Dans vos fauteuils d’Utrecht bonnes vieilles fanées,
Bonnes vieilles voguant sur » le lac » étoilé,
Ô âmes soeurs de Lamartine inconsolé.
Tel aussi j’ai vécu les sanglots de vos harpes
Et vos beaux chevaliers ceints de blanches écharpes
Et vos pâles amants mourant d’un seul baiser.
L’idéal était roi sur un grand coeur brisé.
C’était le temps du patchouli, des janissaires,
D’Elvire, et des turbans, et des hardis corsaires.
Byron disparaissait, somptueux et fatal.
Et le cor dans les bois sonnait sentimental.
Ô mon beau coeur vibrant et pur comme un cristal.
Albert Samain, Le chariot d’or 1 commentaire
1 commentaire
-
Par sylvie erwan le 5 Juin 2021 à 08:00


À Gianetta
Près des ruisseaux, près des cascades,
Dans les champs d’oliviers fleuris,
Sur les rochers, sous les arcades
Dont le temps sape les débris,
Sous les murs du vieux monastère.
Dans le bois qu’aime le mystère,
Sous l’ombre du pin solitaire,
Sous le platane aux frais abris ;
A l’heure où, sous l’humble chaumière.
Le chevrier prend son repas,
A l’heure où brille la lumière,
A l’heure où le jour ne luit pas ;
L’été, quand sous le vert ombrage
Tu viens t’asseoir après l’ouvrage :
L’hiver, par le froid, par l’orage ;
Toujours, partout, je suis tes pas.
Lorsque les cloches argentines
Réveillent l’oiseau dans son nid,
C’est moi qui te suis à matines :
Et quand la prière finit.
Au sortir du temple gothique,
C’est moi qui vais sous le portique
T’offrir, suivant l’usage antique.
L’eau sainte et le rameau bénit.
Quand, vers la fin de la journée,
Tu vas près du saint tribunal,
Devant l’ermite prosternée.
Incliner ton front virginal,
C’est moi qui d’un air humble et tendre.
Quand l’Angélus s’est fait entendre,
Esclave assidu, vais t’attendre
Auprès du confessionnal.
Viens, je te dirai le cantique
Que je suis allé, ce matin.
Choisir pour toi dans la boutique
D’un colporteur napolitain,
Et contre la dent meurtrière
Des loups errants dans la clairière,
Je t’apprendrai quelle prière
Il faut réciter en latin.
Je mettrai dans ton oratoire
Un missel à fermoirs dorés,
Où des moines ont peint l’histoire
De nos anciens livres sacrés ;
Des apôtres les douze images,
La bonne Vierge, et les trois Mages
Au Christ apportant leurs hommages,
Et baisant ses pieds adorés.
Oh, regarde-moi sans colère !
Promets-moi que tu m’aimeras :
Ne me défends pas de te plaire,
Laisse-toi serrer dans mes bras !
Que cette froideur t’abandonne ;
A péché secret Dieu pardonne,
Et je mettrai sur ta madone
Le voile que tu quitteras.
Félix Arvers, Mes heures perdues, 1833 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
cadres bonjour n bonsoir , fonds articles , poésies , astuces , conseils , santé , cadres saisons , cadres f^tes divers etc.3...