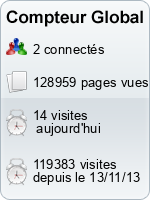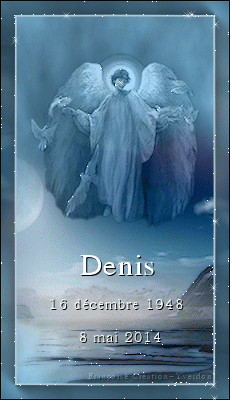-
Par sylvie erwan le 18 Novembre 2013 à 08:25


L'automne
Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards !
Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire,
J'aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois !
Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire,
A ses regards voilés, je trouve plus d'attraits,
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !
Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui,
Je me retourne encore, et d'un regard d'envie
Je contemple ses biens dont je n'ai pas joui !
Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ;
L'air est si parfumé ! la lumière est si pure !
Aux regards d'un mourant le soleil est si beau !
Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-il une goutte de miel ?
Peut-être l'avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu ?
Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore
Aurait compris mon âme, et m'aurait répondu ? ...
La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ;
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ;
Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu'elle expire,
S'exhale comme un son triste et mélodieux.
Alphonse de Lamartine (1790-1869)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par sylvie erwan le 5 Novembre 2013 à 23:27


La Pluie
Lorsque la pluie, ainsi qu’un immense écheveau
Brouillant à l’infini ses longs fils d’eau glacée,
Tombe d’un ciel funèbre et noir comme un caveau
Sur Paris, la Babel hurlante et convulsée,
J’abandonne mon gîte, et sur les ponts de fer,
Sur le macadam, sur les pavés, sur l’asphalte,
Laissant mouiller mon crâne où crépite un enfer,
Je marche à pas fiévreux sans jamais faire halte.
La pluie infiltre en moi des rêves obsédants
Qui me font patauger lentement dans les boues,
Et je m’en vais, rôdeur morne, la pipe aux dents,
Sans cesse éclaboussé par des milliers de roues.
Cette pluie est pour moi le spleen de l’inconnu :
Voilà pourquoi j’ai soif de ces larmes fluettes
Qui sur Paris, le monstre au sanglot continu,
Tombent obliquement lugubres, et muettes.
L’éternel coudoiement des piétons effarés
Ne me révolte plus, tant mes pensers fermentent :
À peine si j’entends les amis rencontrés
Bourdonner d’un air vrai leurs paroles qui mentent.
Mes yeux sont si perdus, si morts et si glacés,
Que dans le va-et-vient des ombres libertines,
Je ne regarde pas sous les jupons troussés
Le gai sautillement des fringantes bottines.
En ruminant tout haut des poèmes de fiel,
J’affronte sans les voir la flaque et la gouttière ;
Et mêlant ma tristesse à la douleur du ciel,
Je marche dans Paris comme en un cimetière.
Et parmi la cohue impure des démons,
Dans le grand labyrinthe, au hasard et sans guide,
Je m’enfonce, et j’aspire alors à pleins poumons
L’affreuse humidité de ce brouillard liquide.
Je suis tout à la pluie ! À son charme assassin,
Les vers dans mon cerveau ruissellent comme une onde :
Car pour moi, le sondeur du triste et du malsain,
C’est de la poésie atroce qui m’inonde.
Maurice Rollinat — Les Névroses votre commentaire
votre commentaire
-
Par sylvie erwan le 1 Novembre 2013 à 10:17


Vieille ferme à la Toussaint
La ferme aux longs murs blancs, sous les grands arbres jaunes,
Regarde, avec les yeux de ses carreaux éteints,
Tomber très lentement, en ce jour de Toussaint,
Les feuillages fanés des frênes et des aunes.
Elle songe et resonge à ceux qui sont ailleurs,
Et qui, de père en fils, longuement s'éreintèrent,
Du pied bêchant le sol, des mains fouillant la terre,
A secouer la plaine à grands coups de labeur.
Puis elle songe encor qu'elle est finie et seule,
Et que ses murs épais et lourds, mais crevassés,
Laissent filtrer la pluie et les brouillards tassés,
Même jusqu'au foyer où s'abrite l'aïeule.
Elle regarde aux horizons bouder les bourgs ;
Des nuages compacts plombent le ciel de Flandre ;
Et tristement, et lourdement se font entendre,
Là-bas, des bonds de glas sautant de tour en tour.
Et quand la chute en or des feuillage effleure,
Larmes ! ses murs flétris et ses pignons usés,
La ferme croit sentir ses lointains trépassés
Qui doucement se rapprochent d'elle, à cette heure,
Et pleurent.

 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
cadres bonjour n bonsoir , fonds articles , poésies , astuces , conseils , santé , cadres saisons , cadres f^tes divers etc.3...